Cet article de Jean Pélégri sur Camus qu'il a connu et aimé à sa façon est un de ceux qui reste à mes yeux le plus vrai et le plus proche de cet homme sur lequel on a pu lire tout un fatras de bêtises prétentieuses et comme toujours lorsqu'il s'agit de Jean il est empreint de modestie et d'une intuition poétique qui donnent l'impression qu'il a été écrit hier...
Pour le confort de la lecture et en regard à la force de cette relation le texte est publié en entier même s'il est un peu long je pense que c'est mieux...
Les lignes qui précèdent le texte sur Camus sont extraites des cahiers inédits que Jean m'a confiés avant de nous quitter il y a quatre ans...
Image Jean Pélégri 2007
Louis Fleury
Etre le Kateb
J’écris ou plutôt je parle, pour être entendu un jour de toute une foule.
Pour que l’homme, qui me lit dans la solitude de sa maison, retrouve dans mes paroles la voix de tous les hommes, ses frères.
Art poétique
Non daté
A propos de Camus, débuts et suites
Article écrit pour la revue Simoun
Jeudi, 22 mai 1960
L’exil et le Royaume
Je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, un soir, à Paris, vers minuit, à la suite d’une rencontre de hasard - dans un café qui faisait face au théâtre où l’on jouait Requiem pour une Nonne. Et nous avions parlé de l’Algérie…
Il est toujours étrange de rencontrer, ailleurs, quelqu’un de son pays : cela donne une impression d’exil. Je l’ai éprouvée ce soir-là, dans la chaleur de ce café à la fois intime et exotique. Les cafés parisiens sont pour nous si différents de ceux d’Alger, que la rue paraît traverser, mais en même temps, à cause de nos lectures et des films, ils nous semble les avoir toujours connus, dans une vie antérieure.
Dehors, c’était une nuit d’hiver. Des autos défilaient derrière les rideaux. On distinguait au passage leur ombre noire, la lueur des veilleuses, le chuintement des pneus sur le goudron mouillé. Qu’il semblait loin le bonheur marin de Tipasa !
Moi, j’essayais d’accorder l’image de l’homme qui me parlait et celle que je m’étais faite de lui, à travers ses livres - j’essayais d’accommoder… Je ne me doutais pas que je n’aurais pas d’autres souvenirs de lui.
Il m’avait pourtant invité à venir le voir. Mais je n’avais pas osé - par pudeur, par fierté. J’attendais d’avoir des raisons plus solides à son estime. En regard de lui je n’étais rien. Ensuite, à l’occasion de mon livre, il m’avait écrit, à plusieurs reprises - mais on n’ose pas croire aux lettres. J’attendais… ! Nous avions, me semblait-il, toute la vie devant nous… Ce n’est qu’après sa mort que j’ai su, par d’autres, que je ne lui étais pas indifférent.
Savais-je d’ailleurs moi-même la profondeur de mon attachement pour lui ? Je pensais qu’il y entrait surtout de l’estime, de l’admiration, une obscure complicité venue d’une terre et d’un ciel communs – peut-être même un sentiment moins désintéressé : celui par lequel nous nous identifions, naïvement, avec un homme de notre pays, quand la gloire le visite. Et puis, un matin, dans le journal, un gros titre, une photo… “ Il y avait, disait le journal, il y avait sur son visage comme de l’étonnement ”.
Moi, dans les jours qui ont suivi, c’est de vivre que j’étais étonné - étonné jusqu’à la stupeur. Chaque fois que je mangeais un fruit, ou que je voyais un rayon de soleil, sur une table, un livre, une robe, je ne pouvais m’empêcher de penser à lui. Je ne pouvais me faire à l’idée que ces simples plaisirs de l’œil et de la bouche, qu’il avait tant aimés, lui fussent désormais interdits. Comment l’imaginer, lui, dans ce définitif exil ? Comment imaginer sans lèvres et sans sourire, sans regard, celui qui nous avait appris à voir - à voir d’un autre œil, celui de l’art et de la mémoire, la mer et le soleil quotidiens ?
Il me semblait aussi qu’avec lui s’était évanouie, du même coup, dans la même vague, toute une région de mon paysage intérieur - qu’une certaine mer, un certain golfe s’étaient engloutis à jamais, un certain printemps “ où les dieux parlent dans le soleil et l’ode ur des absinthes ”.
ur des absinthes ”.
“ Les îles ont fui ”, dit l’Apocalypse… J’avais perdu la mer. Elle s’était retirée de moi. Et Tipasa n’existait plus !
Photo Jean Pélégri détail
Djamel Farès 2000
A cette stupeur, à ce grand vide soudain, s’ajoutait une peine plus simple, plus fondamentale, cette du cœur - “ qui nous fait évoquer des morts les phrases familières ”. Je me souviens qu’avec des amis algériens, pendant ces jours - et il y avait, me semble-t-il, un beau soleil sur Paris, la Seine et les allées du Bois - nous n’avons cessé de parler de lui, essayant d’additionner, dérisoirement, les quelques images, vivantes, que nous avions dans nos mémoires. Comme si ce mort illustre était aussi un mort personnel ! Ce n’était pas seulement un grand écrivain que nous avions perdu, mais quelque chose d’autre - singulièrement nous Algériens - quelque chose comme un frère.
Et aujourd’hui me voilà, comme beaucoup d’autres, avec toutes les conditions de l’amitié - mais sans l’ami. Réduit à me retourner vers mon seul souvenir : cette rencontre au milieu de l’hiver parisien.
Quand je songe à ce soir-là, je me demande s’il l’avait encore en lui, le bonheur de Tipasa. J’aurais dû lui poser la question, elle est importante. Pour nous tous. Mais je ne savais pas… Je l’ai quitté comme on quitte un vivant… Il pleuvait dans la rue - une rue froide qui ne sortait d’aucun de ses livres. De ce fait, elle ressemblait aux rues de l’exil, telles qu’on les imagine. Est-ce ainsi que Paris lui apparut, quand il fut chassé d’Algérie ? Ce qui me frappe en effet, depuis cette rencontre, chaque fois que je le relis, c’est l’importance dans toute son œuvre, l’obsession de ce thème de l’exil.
De l’Etranger jusqu’à l’Hôte, ce thème revient constamment sous sa plume, au propre et au figuré - comme il revient dans sa vie, avec cet intérêt passionné qu’il a toujours montré à l’égard de tous les exilés. Peut-être même le sentiment de l’absurde n’est-il, chez lui, que la transposition métaphysique de ce thème. L’homme exilé de sa terre, s’exile du ciel. C’était là semble-t-il l’épine profonde enfoncée dans sa chair. Et c’est par là que son œuvre est exemplaire pour tous les écrivains algériens, surtout ceux d’origine européenne. Nous sommes tous, en effet, des fils d’exilés, et peut-être, à leur tour, nos fils le seront-ils.
Aussi retrouvons-nous en elle tous nos problèmes et toutes nos difficultés, toutes nos ambiguïtés - ce balancement crucifiant entre nos deux patries : l’Algérie et l’Europe - que connaissent aussi les écrivains musulmans de langue française. L’une est la terre de l’enfance, sans être celle de l’innocence ; l’autre, la capitale de l’esprit. Mais entre les deux, il y a toujours, en nous, une large mer, une mer de séparation -où nous nous obstinons péniblement, vainement peut-être, à dresser des ponts, que la moindre vague emporte. C’est là notre travail de Sisyphe. Il fait de nous des condamnés à la conciliation - à la réconciliation.
Il fut ce condamné, bien avant tous les autres. Inlassablement, il poussa ce rocher - d’abord seul, dans le silence de l’indifférence, puis au milieu des railleries et des huées. Toujours à contretemps, dans la volonté lucide de déranger les conformistes du moment. Il le fit avec passion et mesure - ce qui est la marque du véritable amour, avec l’initiative et la persévérance.
C’est là que se situe mon deuxième souvenir.
C’était à Alger, par un après-midi de janvier 1956. Il était venu inviter les hommes de son pays à une trêve civile, pour épargner les victimes innocentes - et à cause de cela, sa vie était menacée. Cela se passait au Cercle du Progrès sur la place du Gouvernement, ce lieu de rencontre entre deux villes, mais endormi jusque là dans le passé. C’était de cette place, me racontait mon père, pue partaient autrefois les diligences, pour la plaine ou la montagne. Et c’est là qu’adolescent, dans la chaleur de l’après-midi, je prenais, pour aller vers la ferme natale, un car rempli de vieux Arabes à l’allure royale - un car tout bleu.
Je l’avais toujours aimée, cette place : elle était un lieu d’amitié avec les miens, avec la mer. Noces m’avait appris à mieux l’aimer encore, à l’aimer telle qu’elle était - mais avec des mots. Je pensais bien la connaître. Pourtant, en ce soir de janvier 56, elle allait, grâce à lui, prendre un visage tout différent, se métamorphoser.
Sous les arcades, à la grande porte de l’immeuble, deux courants s’opposaient déjà, celui de la fraternité et celui de la violence. Quelle stupeur de reconnaître, au hasard d’un remous, défigurés, des visages de camarades de lycée, avec qui autrefois, pendant la récréation de dix heures, j’avais partagé la “ coca ” à vingt sous - de les voir, pour la première fois, revêtus du masque politique de la haine. La plupart, hésitaient encore entre le chahut et l’émeute. Par moments, une plaisanterie fusait, qui les démasquait. Les rôles, ce soir-là, n’étaient pas encore bien connus. Ce n’était qu’une répétition.
Je n’avais pu entrer, faute de carte, et j’étais allé m’adosser à un ficus. Autour, sur la place, dans le ciel, c’était le crépuscule - tel qu’il l’avait toujours décrit : le jour, avec ses certitudes, basculait dans la nuit. Pourtant, ce soir-là, à cause de lui, on pouvait espérer encore - résister à cette défaillance de la lumière. La nuit n’était pas totale. Au troisième étage, les grandes fenêtres du Cercle du Progrès étaient illuminées, fastueusement. Et en les regardant, je me sentais un peu comme le pauvre de Victor Hugo qui contemple, avec envie, le festin auquel il n’a pas été convié. Là-haut, dans cette salle où contre le même désespoir se coudoyaient Musulmans et Européens, c’était peut-être - moment encore plus éphémère que la gloire fragile du jour - c’était peut-être le dernier festin de l’amitié !
C’est alors que se produisit la métamorphose. La place, avec ses maigres arbres, ses mendiants, sa foule du soir, ses trams bondés, sombrait - mais pas dans la détresse de la nuit, comme à l’ordinaire. Elle semblait naître au contraire, basculer dans une existence nouvelle, s’éveiller brusquement d’un long sommeil pittoresque et colonial - celui que beaucoup d’écrivains de passage, Gide par exemple, avait décrit, fixé, comme on le fait des papillons morts, en les épinglant. Ce soir-là, une passion la traversait, une passion neuve et sombre - la sienne.
Un moment même, il me sembla que le décor, pourtant familier, surgissait soudain… d’un roman de Dostoïevski - cet auteur qu’il avait lu dans sa chambre de Belcourt, fenêtre ouverte sur les bruits de la rue, et par lequel il avait appris, lui le Méditerranéen, à donner sens, profondeur et mystère au paysage ensoleillé de ses certitudes. En effet, sous mes yeux, cette place se faisait fiévreuse, exaltée, fascinante, blanche et noire comme le mal et le bien. Etrange dépaysement !
C’est à cet instant, sans doute, que je l’ai le plus profondément admiré, et secrètement envié. Rares en effet sont les écrivains qui peuvent ainsi accorder leur œuvre avec leur vie et réussir, dans la même démarche, cette double création. Lui, par sa seule présence, il était parvenu à donner sens nouveau au quotidien, à éveiller ce qui était endormi. Sa présence, et son courage, stylisaient en quelque sorte le réel. Si bien que sa vie, à l’image du soir, prenait le visage d’un destin. “ Les mots de la fin étaient prononcés ”.

C’était la dernière répétition de la tragédie qui commençait. Déjà, en effet, tandis qu’il parlait pour éveiller et pour réunir, des hommes s’étaient groupés sur la place - ses frères de race - et, comme pour l’exiler une nouvelle fois, ils le huaient, avec des cris de mort. Ils le huaient dans la ville de sa mère… “ Oui, tu es mon frère, et vous êtes mes frères que j’aime. Mais quel goût affreux a parfois la fraternité ! ” Ensuite, dans la nuit tombée, devant la statue du Duc d’Orléans, ils avaient allumé un grand feu, qui éclairait les naseaux du cheval de bronze - le premier feu de la haine.
Pendant les mois, les années qui allaient suivre, nous n’aurions, pour éclairer notre nuit, que ce seul feu. Encore aujourd’hui, il nous glace. Mais qui saura encore nous dire qu’il y a, pour les hommes d’un même pays, d’autres recours que celui-là pour faire face au désespoir, pour équilibrer les forces de la nuit ?
Aussi est-ce toujours vers ce souvenir de janvier 56 que je me suis retourné, chaque fois qu’à Paris ou ailleurs, j’ai entendu certains critiquer, jusqu’à l’insulte, du fond de leur fauteuil et avec la bêtise doctorale de l’ignorance ou de la haine, ce qu’ils appellent “ le silence de Camus ” !… Beaucoup font les braves, dit Bertolt Brecht, comme si les canons étaient braqués sur eux - alors qu’il s’agit simplement de lorgnettes de théâtre . Et c’est vers ce souvenir que je retournerai encore, si un jour, quand ils auront vingt ans, je devais rencontrer les enfants de Camus. Oui, je leur parlerai de ce soir-là - pour qu’ils puissent, un instant, savourer ce très doux bonheur : être fier du courage de son père.
Je voudrais, pour conclure, exprimer un vœu, un vœu naïf, dont il aurait lui-même souri… Il faudrait qu’un jour, une fois la paix revenue et Tipasa délivrée de ses barbelés, cette place, ou une autre, porte son nom - pour que son exemple, qui aujourd’hui encore nous invite à na pas désespérer, ne soit pas oublié. Ne sommes-nous pas d’une terre où l’on aime honorer les morts ? Et peut-être pourrons-nous ainsi dans ce geste dérisoire, oublier un peu qu’à plusieurs reprises, nous l’avons condamné à l’hiver de l’exil.
On graverait sur une plaque - mais assez haut, pour la mettre à l’abri des imbéciles - les mots qu’il prononçait ce soir-là : “ En ce qui me concerne, j’ai aimé avec passion cette terre où je suis né, j’y ai puisé tout ce que je suis, et je n’ai jamais séparé dans mon amitié aucun des hommes qui y vivent, de quelque race qu’ils soient. Bien que j’aie connu et partagé les misères qui ne lui manquent pas, elle est restée pour moi la terre du bonheur, de l’énergie et de la création. Et je ne puis me résigner à la voir devenir pour longtemps la terre du malheur et de la haine… Puisque c’est là notre tâche, si obscure et ingrate qu’elle soit, nous devons l’aborder avec décisio n, pour mériter un jour de vivre en hommes libres. ”
n, pour mériter un jour de vivre en hommes libres. ”
Ce serait une consolation, pour nous qui sommes du royaume, de se donner rendez-vous sur cette place avec des amis, avant d’aller vers le port - une petite consolation - malgré l’incroyable étrangeté de voir ainsi pétrifié, à jamais, celui qui fut notre jeunesse.
On se souviendrait plus facilement, en lisant ces mots, ces mots déjà tout préparés pour la fin, de ce jeune homme en costume blanc qui marchait vers la mer, sous le soleil - au temps de l’invincible été.
De longs extraits de ce texte ont été publiés dans le livre sous forme de dialogue Jean Pélégri l'Algérien Le scribe du caillou Ed.Marsa, 2000






 e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...
 re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...
re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous
en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...



 sage le plus fort de sens des
sage le plus fort de sens des 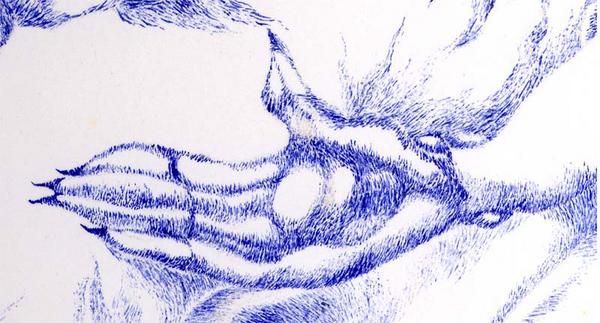

 en du tout… Et le matin se ramenait dans le soleil orange du brasero pendant qu’on mangeait avant de se séparer la soupe aux haricots ou aux lentilles qu’avait apportée Benjamin dans sa gamelle fumante qui nous vidait l’estomac des coups de poing courants d’air.
en du tout… Et le matin se ramenait dans le soleil orange du brasero pendant qu’on mangeait avant de se séparer la soupe aux haricots ou aux lentilles qu’avait apportée Benjamin dans sa gamelle fumante qui nous vidait l’estomac des coups de poing courants d’air.



 eminots comme on disait… C’était les chevaliers modernes d’un Grall qui se tirait devant carapatait et qu’il atteindraient pas… la prochaine gare… la prochaine gare…
eminots comme on disait… C’était les chevaliers modernes d’un Grall qui se tirait devant carapatait et qu’il atteindraient pas… la prochaine gare… la prochaine gare… ns qui bougeaient couraient s’appelaient braillaient et qui n’les reluquaient pas… Pour les voir d’ailleurs fallait être aussi seul que sont les mômes et à la même hauteur que ces gens assis le dos rond les épaules un peu voûtées la tête des femmes on la devinait à cause des foulards blacks les jeunes aussi qui dépassait presque pas des amoncellements grotesques de paquets des collines rigolotes et tristes on aurait dit que tout ça était à vendre un jour de marché…
ns qui bougeaient couraient s’appelaient braillaient et qui n’les reluquaient pas… Pour les voir d’ailleurs fallait être aussi seul que sont les mômes et à la même hauteur que ces gens assis le dos rond les épaules un peu voûtées la tête des femmes on la devinait à cause des foulards blacks les jeunes aussi qui dépassait presque pas des amoncellements grotesques de paquets des collines rigolotes et tristes on aurait dit que tout ça était à vendre un jour de marché…
 dans l'espoir de la dépasser, aussi bien pour l'homme noir que pour l'homme blanc. ”
dans l'espoir de la dépasser, aussi bien pour l'homme noir que pour l'homme blanc. ”






 ous en ai déjà parlé mais là tout de suite vous dire juste que mémé et moi on avait pile poil 80 balais de différence à six jours près ça vous dit quelque chose ? Mémé est née en 1876 le 24 août et moi en 1956 le 31 août ce qui fait que si elle avait pas décidé d’un coup de mauvaise humeur de nous larguer à 98 piges on aurait eu elle 100 ans et moi 20 quasi en même temps ! Et faut vous dire aussi que mémé avec son caractère un peu hors normes je lui ressemble je crois comme à son père Sylvain pour la bougeotte…
ous en ai déjà parlé mais là tout de suite vous dire juste que mémé et moi on avait pile poil 80 balais de différence à six jours près ça vous dit quelque chose ? Mémé est née en 1876 le 24 août et moi en 1956 le 31 août ce qui fait que si elle avait pas décidé d’un coup de mauvaise humeur de nous larguer à 98 piges on aurait eu elle 100 ans et moi 20 quasi en même temps ! Et faut vous dire aussi que mémé avec son caractère un peu hors normes je lui ressemble je crois comme à son père Sylvain pour la bougeotte…
 ollectionneurs d’accidents du travail et autres calamités enfer de ces temps sans rien… Mathilde elle je l’ai pas fréquentée pour cause qu’elle est morte en couche à un peu plus de 20 ans…
ollectionneurs d’accidents du travail et autres calamités enfer de ces temps sans rien… Mathilde elle je l’ai pas fréquentée pour cause qu’elle est morte en couche à un peu plus de 20 ans… e la dignité humaine et de la bonté qui étaient les leurs plein de tendresse et une grande fieté d'être issue d'une histoire comme la leur : celle des ouvriers et ouvrières paysans et paysannes qui ont écrit avec leur vie le merveilleux roman de Georges-Emmanuel Clancier
e la dignité humaine et de la bonté qui étaient les leurs plein de tendresse et une grande fieté d'être issue d'une histoire comme la leur : celle des ouvriers et ouvrières paysans et paysannes qui ont écrit avec leur vie le merveilleux roman de Georges-Emmanuel Clancier 

 ieux écrire des livres que faire la guerre
ieux écrire des livres que faire la guerre
